[Rencontre virtuelle] Aminata Aidara

Rencontre à distance avec Aminata Aidara, auteure que Le Grand R aurait dû recevoir en résidence en ce mois d’avril 2020.
Je suis quelqu’un qui a vu un enfant un jour, un nourrisson qui a disparu. Je suis quelqu’un qui connaît un secret. Probablement que je le sais depuis longtemps, parce que ça ne me détruit pas d’apprendre son existence. Je suis choquée, par contre, que mon père en dise le nom à haute voix : « le fils de l’Autre ! » Personne ne l’a jamais fait, nommer l’innommable.
Je suis quelqu’un, Gallimard, coll. Continents noirs, 2018
Estelle, jeune femme libre, apprend de la bouche de son père l’existence et la disparition quasi immédiate d’un frère, fruit de la relation de Penda, sa mère, avec un autre homme. C’est là que commence, pour les personnages, une longue quête : de la vérité, d’une identité, plurielle, troublée, partagée entre le Sénégal et la France.
Aminata Aidara est journaliste et universitaire italo-sénégalaise. Ses articles et essais portent sur la complexité identitaire post-coloniale, le traitement de l’expérience de l’immigration dans la littérature française et francophone et le rapport à la littérature à la littérature des jeunes issus de l’immigration en France. Elle collabore régulièrement avec la remarquable revue Africultures.
Je suis quelqu’un est son premier roman.
Aminata aurait dû être en résidence auprès du Grand R en avril, elle nous fait le plaisir de nous accorder un petit entretien à distance, conformément aux mesures actuelles.
_
Chère Aminata, merci pour commencer de prendre ce temps pour toutes les personnes qui auraient eu plaisir à vous découvrir et à vous rencontrer. Comment allez-vous au cœur de cette situation inédite, étrange, et pleine d’inquiétude ?
Je vais bien, merci. Je suis confinée en France, où je réside, et j’observe de chez moi, non sans inquiétude, ce qui est en train de se passer dans notre monde dépassé par lui-même.
Est-ce que parvenez à mettre à profit cette période de confinement contraint pour des projets d’écriture ? Ou a-t-elle même provoqué de nouvelles nécessités de textes ?
Pour certain·e·s c’est un moment prolifique, artistiquement parlant. De mon côté, en revanche, j’écris souvent dans le mouvement, dans la rencontre avec les gens, dans le brouhaha du monde, et tout le tralala d’une vie qui emprunte à la rue, les parcs, les bars, les plages, les montagnes de quoi se calmer et se nourrir en même temps. Pour moi, le Confinement est propice à l’introspection, donc oui je tiens un journal intime, mais non, je ne l’appellerai pas « Journal de confinement » : c’est mon journal de toujours, peut-être un peu plus dense que d’habitude. Ceci dit, puisque je suis maman d’un nourrisson, mon occupation principale en ce moment, c’est lui ! Le Confinement et les communications intenses entre proches qu’il provoque, confirme mon envie d’explorer davantage l’écriture épistolaire, que ce soit par mail, chat ou messages vocaux.
Contrairement à ce que nous vivons aujourd’hui, dans votre roman, Je suis quelqu’un, le monde est vaste et élargi, on peut le parcourir, de Paris à Dakar, vous êtes vous-même d’origine italienne et sénégalaise. Où étiez-vous quand vous l’avez écrit ?
Quand j’ai écrit mon roman, j’étais à Paris, mais aussi, un peu, à Dakar et à Brescia. Il s’est écrit par fragments. J’ai mis pas mal de temps à comprendre que ce que j’écrivais allait devenir un roman.
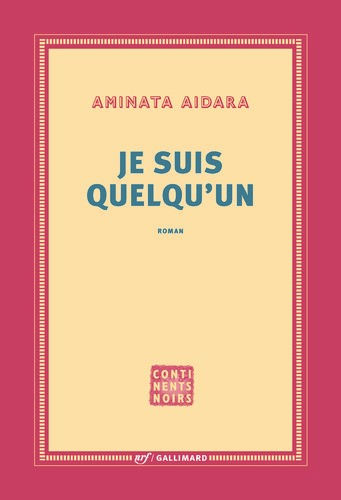 Ce livre, vous l’avez écrit en français, mais vous avez aussi déjà publié en italien, était-ce une évidence sans questionnement d’écrire en français ce premier roman ?
Ce livre, vous l’avez écrit en français, mais vous avez aussi déjà publié en italien, était-ce une évidence sans questionnement d’écrire en français ce premier roman ?
Je suis quelqu’un est né en italien. Le premier jet était donc dans ma langue maternelle. Mais comme vous l’avez souligné, j’avais publié un recueil de nouvelles en Italie auparavant (La ragazza dal cuore di carta), et il se trouve que l’éditeur de la collection Continents noirs de Gallimard l’a lu et m’a demandé si j’avais un roman dans mon tiroir… écrit en français ! Je l’ai donc retravaillé et traduit, deux opérations qui se sont mises en place simultanément. Cela a été un exercice fécond et très stimulant pour peaufiner les nuances et l’expression des sentiments entre une langue et l’autre.
Votre livre « où il est question d’un secret qui hante les membres d’une famille éclatée entre la France et le Sénégal » s’ouvre dès les premières pages avec le père d’Estelle, votre personnage principal – une jeune étudiante de 26 ans – et l’annonce de l’existence d’un frère adultérin, disparu depuis. On croit partir sur une histoire familiale mais très vite, on sent bien que ce n’est pas le seul sujet. Ça explose dans le texte. Ce silence brisé n’est-il pas un prétexte pour parler d’autre chose ?
Oui, certainement. Je pars toujours d’histoires du quotidien ou de dynamiques familiales pour élargir le champ (bien sûr si les trajectoires en question m’invitent à le faire). La base est de raconter une histoire, et puis si celle-ci me permet d’aborder d’autres sujets plus vastes, tant mieux. Nos premières expériences, notre socialisation primaire, non seulement influencent le reste de notre vie, mais sont aussi un échantillon de communauté, de société, de monde. Dans Je suis quelqu’un, la famille incorpore l’histoire coloniale et une partie de ses séquelles. Lors de rencontres autour de mon roman, certain.e.s lect·eurs·rices m’ont demandé si le thème de mon roman était donc l’identité. Le fait est qu’il s’agit d’un roman à propos d’une famille sénégalaise qui émigre en France. Dès lors, comment ne pas prendre en compte des dynamiques liées à l’actualité ? Elles sont dans le roman, mais pour moi les sujets principaux de cette histoire restent l’amour, de trahison, la sororité, la filiation et l’amitié. J’entends que pour un lectorat qui n’a pas vécu dans sa chair le fait d’être perçu comme différent, c’est une vraie question. Mais la réalité est que je m’interroge plutôt sur la place de chacun, au sein de sa famille et dans la société, et ce, vis-à-vis notamment des injonctions différentes qui peuvent être assenées dès la naissance par l’une et par l’autre. Si je parle de postcolonialisme, de métissage et de racisme, ce n’est que parce que pour toute personne faisant partie d’une « minorité visible » c’est un aspect, comme un autre, de son parcours d’individu dans le monde.
Vous entremêlez vos personnages (Penda, la mère, dans son journal intime, Estelle, la fille dans ses délires, Éric, le père, dans son évanescence…), chacun d’entre eux se débat à sa manière avec ses mots, son langage : est-ce une polyphonie que vous avez voulu travailler dans votre écriture pour décrire une forme de cacophonie, de multiplicité et de singularité des individus ?
J’ai donné à tout personnage la possibilité d’exister de la façon qui lui correspondait le plus, c’est à dire de la manière avec laquelle je le figurais dans ma tête. Dialikà, par exemple, n’est pas quelqu’un qui aime s’exprimer à travers les mails, alors que c’est le cas de Mansour. Estelle est stressée par l’urgence des communications, et repousse à demain ses réponses, Penda a besoin d’y voir plus clair, de faire le point sur sa vie. D’où les messages vocaux, les lettres, les délires, le journal intime… Je ne pouvais que l’écrire comme ça !
Vous questionnez beaucoup dans votre roman la double culture, l’histoire coloniale, le poids de l’héritage culturel, les immigrés afro descendant, les métis : Estelle cherche à se construire sans vouloir voir le miroir que lui tend la société, elle souhaite être juste une personne, ni blanche ni noire, ainsi que la majorité de vos autres personnages qui cherchent eux aussi à sortir des cases. Pensez-vous qu’il est possible de se construire de façon libre et autonome ?
Non, ce n’est pas possible, à moins d’aller vivre en confinement, en ermitage quelque part, sans contacts avec la société. Ou encore mieux, d’avoir toujours vécu ainsi. Nos relations aux autres nous façonnent dès les premiers instants de notre vie. Pour autant cela ne nous empêche pas, à mes personnages comme à moi et à qui voudra le faire, d’essayer de d’exploser les cases, de rendre poreuses les frontières, de se débarrasser des stigmates. La liberté n’est pas donnée en cadeau, c’est un exercice quotidien, une conquête constante.
Je suis quelqu’un, cette litanie qui donne aussi son titre au roman, constitue-t-elle cette affirmation ferme et complète ? Des êtres qui sont entiers en étant pluriels ?
Avec la signification que vous suggérez, il s’agirait de considérer que l’on a besoin de dire que l’on est quelqu’un dans le sens d’une personne entière et ayant les mêmes droits que les autres. Cela supposerait donc qu’il soit nécessaire d’affirmer son humanité face à quelqu’un qui voudrait nous l’ôter, ou qui la remettrait en cause. Bien sûr, aujourd’hui (comme hier) il y a l’urgence de préserver la survie des personnes discriminées, exploitées… et de se battre pour cela, individuellement et collectivement. Le mouvement Black Lives Matter, pour ne prendre que cet exemple, est né face à l’ampleur de crimes commis contre des populations noires. Les luttes ouvrières existent pour défendre les personnes contraintes de travailler dans des conditions inhumaines et toxiques pour la santé. Mais concernant mon roman, le leitmotiv « je suis quelqu’un » signifie « je suis quelqu’un qui fait ceci, qui pense cela, qui écrit ça » etc. Il s’agit d’affirmer son existence en espérant que ses actes comptent plus que ce que son corps annonce au monde, puisque cette annonce est biaisée par le prisme de chacun et anticipe souvent la réelle connaissance de l’autre. C’est le « je suis quelqu’un » de personnes qui veulent se débarrasser des préjugés : l’autre n’a pas à dire qui je suis avant que ça soit à moi de le décider. C’est le combat perpétuel entre ce qui nous est imposé et ce que nous avons envie d’être.
Vous citez au long de votre livre de nombreux penseurs de l’histoire postcoloniale – l’ethnopsychiatre Franz Fanon, l’écrivaine Léonora Miano par exemple – sont-ils pour vous des « guides » dans votre propre quête ? Et d’ailleurs que serait cette quête ?
Ce sont des écrivain·e·s qui ont su et savent nommer des blessures historiques. C’est une capacité que j’apprécie beaucoup. Les deux ont produit et produisent des essais qui sont comme des envolées poétiques toujours en mesure de s’accrocher à l’essentiel, c’est-à-dire qu’ils·elles entremêlent le théorique et le concret, avec des mélodies qui nous font comprendre de quoi il s’agit avant même de devoir en déchiffrer les notes. La quête que je partage avec eux et qui me les rend exemplaires et admirables c’est bien celle-là : arriver à porter les maux avec les mots.
Vous avez un doctorat en littérature française, obtenu récemment en 2016, dont le titre de votre recherche était : Exister à bout de plume, la littérature des jeunes générations françaises issues de l’immigration au prisme de l’anthropologie littéraire. N’était-ce pas là le déclencheur de ce qu’il allait ensuite s’écrire de manière romanesque ? Saviez-vous en préparant votre thèse que vous iriez du côté du roman, de la fiction ?
La gestation et l’élaboration du roman en italien et la rédaction de la thèse se sont faites en même temps ! La traduction et réécriture du roman en français, en revanche, s’est faite après. D’ailleurs ma thèse concerne l’analyse sociologique et anthropologique de l’objet littéraire et, en quelque sorte, mon roman traite de la société contemporaine. Ça a été un double mouvement assez spontané.
Vous êtes également journaliste, vous travaillez notamment pour la revue Africultures. Quel est en tant qu’écrivaine et journaliste, votre rapport à la frontière entre les fictions (romans) et les documents (non-fiction).
J’aime bien des fictions qui seraient « possibles », donc des fictions réalistes. La frontière est là où on décide de la mettre, et souvent les deux se nourrissent réciproquement. Combien de fois des lectures ont modifié notre façon de voir les choses, notre vocabulaire, notre approche à certains thèmes ? Et la fiction n’est-elle pas juste un monde parallèle au notre, se nourrissant de ce premier pour faire exister ce qu’on souhaiterait vivre ?
Et demain ?
La suite de Je suis quelqu’un, un recueil de nouvelles, et la biographie d’un homme italo-somalien né dans les années 40. Et bien sûr, lire, lire et encore lire.

